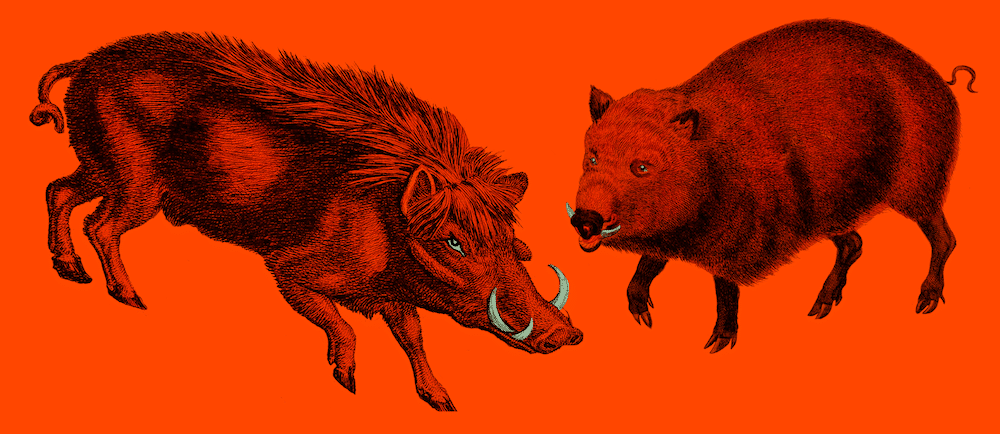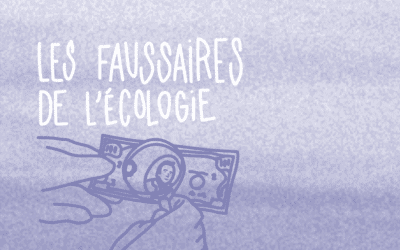Fracas poursuit sa série sur les espèces mal-aimées en dressant le portrait d’un mammifère qui prolifère dans les campagnes françaises : le sanglier. Considéré comme une créature diabolique au Moyen Âge, l’animal traîne désormais une réputation de ravageur de cultures, voire d’agresseur de promeneurs. Pourtant, l’espèce incarne mieux qu’aucune autre la frontière trouble entre le sauvage et le domestique.
Un article de Damien Mestre issu du n°5 de Fracas.
«Bête vicieuse» et «puante», «incarnation du diable»… Le Moyen Âge est d’abord cruel avec les sangliers. Dans une époque toute tournée vers Dieu et les cieux, impossible alors de juger autrement ce mammifère – gras et hirsute – qui passe sa vie la tête dans la boue, à retourner la basse terre avec son groin. Un gros dégueulasse, le sanglier ? En tout cas, sa description le montre bien éloigné des vertus catholiques. Il est «comme les gens qui recherchent bons vins et bonnes viandes, courtisent les délices de la chair et pensent qu’il n’y a point d’autres paradis». Les mots sont ceux d’un gentilhomme normand, Henri de Ferrières, à qui l’on attribue l’écriture d’un des plus anciens traités de chasse en langue française (1). L’animal est selon lui «hypocrite et irascible», comme le sont les hommes qui «n’ont pas de charité ni d’humilité, et sont pleins de vices et de félonie». Après avoir tout fouillé et mangé, le sanglier fait son lit à même le sol, se roule dans la saleté. Preuve supplémentaire de sa bassesse morale ? Le chasseur médiéval conclut : «son âme ira au puits d’enfer pour la gloire d’Antéchrist» ! Rien que ça.
Souille, coup de boutoir et canines aiguisées
Aujourd’hui, plus grand monde n’incrimine la «bête noire» pour son soi-disant manque de chasteté chrétienne. Mais en y pensant, notre vision du sanglier a-t-elle réellement changé depuis les textes médiévaux ? On lui reproche toujours de retourner le sol des champs et des jardins (les spécialistes disent qu’il «mulotte», ou qu’il «vermille») – causant au passage d’importants dégâts dans les cultures agricoles. Les promeneurs craignent de le croiser en forêt. On redoute ses coups de «boutoir», le nom donné à l’extrémité de sa face tout allongée. Son allure trapue, son corps massif qui peut dépasser les 100 kilos, les longues canines aiguisées du mâle qui lui servent de défenses… rien n’inspire confiance. Et puis, il est bien vrai que le sanglier est obsédé par la boue. Il passe son temps à chercher des «souilles» – ces mares ou grosses flaques de fange dans lesquelles il vient se vautrer. Ceux qui l’étudient expliquent que cela lui permet de se débarrasser des parasites. En séchant, la glaise forme aussi une sorte de carapace qui le protège des piqûres d’insectes. Les chasseurs le savent : c’est en repérant des traces de boue contre un tronc d’arbre qu’ils détectent la présence du gibier venu s’y frotter.
Il est « comme les gens qui recherchent bons vins et bonnes viandes, courtisent les délices de la chair et pensent qu’il n’y a point d’autre paradis »
Autre motif d’inquiétude : sa tendance à proliférer rapidement. Le sanglier pullule en France depuis cinquante ans. Au début des années 1970, 35 000 sangliers étaient tués chaque année par les plus de deux millions de chasseurs que comptait la France. En 2024, ce nombre dépasse la barre des 800 000… pour moitié moins de tireurs, selon les chiffres de la Fédération nationale des chasseurs. Comment l’expliquer ? Il faut d’abord reconnaître l’incroyable capacité d’adaptation de cet animal. Son régime alimentaire particulièrement riche lui permet d’affronter tout un tas de circonstances. Grand amateur de glands, de châtaignes et de faînes (le fruit du hêtre), il peut également pratiquer le glanage illégal en fonction des opportunités agricoles du moment : pomme de terre, betterave, maïs… tout y passe, y compris les belles grappes de raisin mûr à quelques jours des vendanges. Avec son boutoir, qu’il utilise comme le soc d’une charrue, il piste aussi les vers et les petits mulots. Grenouilles, serpents et œufs d’oiseau peuvent enfin compléter le repas.
Problème : lorsque cette nourriture est abondante, certaines femelles accélèrent leur cycle de reproduction et mettent bas deux fois dans l’année. Chaque portée compte en moyenne cinq à six marcassins, un chiffre élevé comparé aux chevreuils et aux cerfs. Des petits qui seront ensuite élevés en commun par un groupe de femelles regroupées en «compagnie». Composé de plusieurs mères, ce clan suit une organisation matriarcale : c’est la plus vieille laie du groupe qui occupe le poste dominant et dirige en général les autres lors des déplacements. Les marcassins – réputés très joueurs – chahutent et grandissent ensemble sous la surveillance de tous les membres de la compagnie. Il est d’ailleurs fréquent qu’en cas de décès d’une mère, les marcassins orphelins soient élevés par les autres laies. Quant aux mâles, ils sont forcés de quitter le groupe une fois devenus jeunes adultes. Ils évoluent alors en marge, avant de basculer dans une vie de plus en plus solitaire.
La faute aux chasseurs ?
Après des décennies de prolifération, l’évolution des sangliers est devenue gentiment ingérable en France. Les pertes pour les agriculteurs se chiffrent chaque année en millions d’euros. Tout comme le coût pour les compagnies d’assurance, forcées de payer les frais de garagiste engendrés par les milliers de collisions annuelles entre automobilistes et sangliers. Et ce, malgré les efforts toujours plus importants de «régulation». Les périodes de chasse sont sans cesse étendues, département par département, en fonction des différentes dérogations préfectorales.
Paradoxalement, c’est justement le rôle des chasseurs qui est aujourd’hui pointé du doigt par les spécialistes. Ce sont eux qui ont favorisé la reproduction de l’espèce à partir de la fin des années 1960, décrivent les écologues et géographes Raphaël Mathevet et Roméo Bondon, dans un livre paru en 2022 (2). Élevages de sangliers relâchés dans la nature, nourrissage d’animaux en forêt pour les aider à passer l’hiver, mise en avant d’une chasse «conservatrice» visant à épargner les mâles reproducteurs…
Durant des années, de façon plus ou moins officielle, les chasseurs ont multiplié les pratiques favorables au mammifère. Une façon de compenser, expliquent les auteurs, la disparition progressive du petit gibier (perdrix, bécasse, lapin…), victime de la modernisation de l’agriculture. Le tout, sur fond de changement climatique bénéfique aux sangliers – et alors que les loups et les lynx, uniques prédateurs de l’espèce, ont été éradiqués des forêts. En cela, le sanglier évolue depuis cinquante ans en marge de notre société. Dans un espace naturel, certes, mais presque aménagé à sa gloire.
Peut-on encore parler d’animal sauvage ? Pas tout à fait, répondent les écologues. Pas plus que de domestication… Le sanglier semble cheminer sur une troisième voie. Ni «bête indomptable» du Moyen Âge, ni cochon d’élevage. Un animal «cynégétisé», propose l’archéozoologue Jean-Denis Vigne, chercheur au CNRS. En clair : façonné par et pour la chasse. Ou pour reprendre l’expression d’une autre scientifique (3) : «sauvage… mais pas trop» !