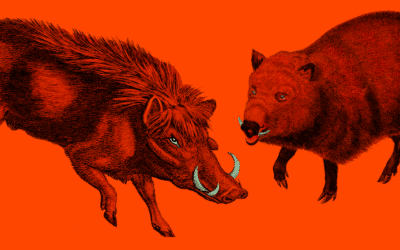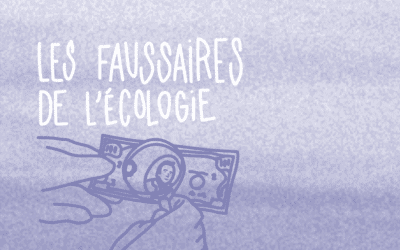La deuxième édition des Résistantes, grand-messe de l’écologie militante, s’est tenue du 7 au 10 août à Saint-Hilaire-de-Briouze, dans l’Orne, et a réuni 7 000 participant·es. Quatre jours de débats, tables rondes, performances artistiques et vie collective en autogestion, marqués cette année par l’actualité mouvementée de la loi Duplomb. L’occasion pour celles et ceux qui luttent contre les pesticides de faire connaître leurs combats, pour les autres de s’instruire – et de les rejoindre.
Cet article est issu du cinquième numéro de Fracas.
Une file sans fin s’étire entre les chapiteaux bleu, jaune, rouge, happée par le fumet de la cantine autogérée. Des tentes bourgeonnent par grappes au loin, sur les terrains de cinq fermes normandes nous offrant l’hospitalité. Le premier qui appelle les Résistantes « festival » se fait rapidement reprendre par son voisin d’attente : c’est un village temporaire qui semble avoir poussé sur ces quelques hectares foulés par 7 000 paires de pieds en quatre jours. Venu·es de tout le pays et d’ailleurs, les participant·es naviguent entre tables rondes, ateliers, performances, assemblées et coup de pouce à la plonge ou à la découpe des légumes… les Résistantes ne sont pas seulement une fête, mais bien un événement militant, pensé par et pour celles et ceux qui mènent des luttes écologistes en France, locales ou globales.
Deux ans après une première édition sur le plateau du Larzac, ces retrouvailles dans le verdoyant bocage ornais s’ouvrent tout de même en ce 7 août 2025 sur une petite victoire à arroser : la loi Duplomb – texte facilitant l’usage de pesticides dangereux, la construction de mégabassines et l’élevage industriel – vient d’être partiellement censurée par le Conseil constitutionnel. L’acétamipride ne sera pas réintroduit. Enfin, pas tout de suite. « Cette décision nous apprend une chose, c’est que le rapport de force fonctionne. Et comme il reste 288 molécules nocives pour la santé et l’environnement utilisées en agriculture, on ne va pas s’arrêter là », assène Fleur Breteau, fondatrice du collectif Cancer Colère, sur le plateau de C dans l’air, avant de rejoindre le camp des Résistantes. Car si l’opposition à loi Duplomb a largement mobilisé, sa censure partielle est une victoire à la Pyrrhus pour la plupart des collectifs, déjà tournés vers la recherche de nouveaux leviers d’action pour continuer le combat. « Il ne faut pas que le soufflé retombe », résume Sylvie Nony, vice-présidente de l’association Alerte Pesticides Haute-Gironde et physicienne de métier, qui anime une discussion intitulée : « Le long combat des travailleur·euses empoisonné·es ». Autour de la table, plusieurs agriculteurs malades, une sociologue, et Me François Lafforgue, avocat de nombreuses victimes, connu pour avoir fait condamner Monsanto (1) et défendu les parents d’Emmy Marivain, décédée à 11 ans d’une leucémie, alors que sa mère, ex-fleuriste, avait été exposée aux pesticides pendant sa grossesse.
« Plus jamais ça »
« Il m’a fallu faire mon coming-out de malade après des années de déni », ouvre Gérard. Cet agriculteur, empoisonné en 1984, n’en parlera que 23 ans plus tard. Le déclic ? La sortie du livre Pesticides, révélations sur un scandale français : « Le maire avait proposé une discussion entre les auteurs et les paysans de la commune, se souvient-il. Mais la chambre d’Agriculture avait imposé la présence d’un lobbyiste des pesticides, qui a dit que ce qu’on épandait était tellement inoffensif qu’on pourrait presque le boire. » Une outrance pour cet homme qui tait depuis plus de vingt ans ses maux, dont des troubles érectiles, dus aux produits qu’il a manipulés : il se lève et dit tout. Lui qui craignait les quolibets fait alors face à un silence épais et entendu. Comme aujourd’hui, aux Résistantes. L’un est atteint d’un cancer de la prostate, l’autre de Parkinson, tous ont perdu ou accompagnent dans la maladie des collègues, voisins, frères ou conjointe.
« Plus jamais ça », répond et répète la sociologue spécialisée en santé publique Annie Thébaud-Mony, 80 ans, tenant d’une main ferme la feuille où s’étend son discours en fines lettres manuscrites. Cofondatrice du Groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle et du fonds de dotation Agir contre les cancers du travail, elle a consacré sa vie à la reconnaissance des maladies professionnelles et contribué à faire interdire l’amiante en France. « On a besoin d’épidémiologistes, de militants, de riverains, de chercheurs, d’avocats, de journalistes d’investigation… Il faut mettre en commun nos savoirs et sortir des clivages portés par la FNSEA », égraine celle qui a souvent jeté des passerelles entre les différent·es opposant·es aux pesticides : scientifiques, avocats, collectifs de malades, syndicalistes dans les entreprises incriminées… Lorsque François Lafforgue prend le micro, la conférence revêt des allures de permanence juridique.

Parmi les quelque 150 auditeur·ices, des mains se lèvent. Une femme, saisonnière, se demande si elle dispose d’un droit de retrait en cas de mésusage des pesticides sur une exploitation, ou d’absence de matériel de protection adapté. « Il y a bien un décret qui vous protège, et même, en théorie, un devoir d’alerte », confirme l’avocat, avant d’admettre que ce dernier est rarement invoqué, étant donné la précarité des travailleur·euses. « Il faut vraiment se rapprocher des structures syndicales, c’est ce qui permet de se défendre, et d’attaquer à plusieurs », recommande François Lafforgue, en costume au milieu des t-shirts à message, keffiehs et pantalons de randonnée.
Contrer les clivages, se lier dans la durée
Un peu plus tôt dans la matinée, une « assemblée des luttes contre les pesticides » tranchait avec le format parfois péremptoire des tables rondes, et a permis l’émergence d’outils concrets, par la rencontre entre les collectifs et individus présents – notamment le Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’Ouest (CSVPO), Cancer Colère et des associations locales. « Le CSVPO, c’est 600 personnes dont 450 malades, elles et ils sont tous·tes assez âgé·es, et n’ont pas le parcours écolo militant classique. Ils sont repartis avec de l’espoir, ont découvert qu’ils n’étaient pas seuls, que des convergences étaient possibles, se félicite Amand, animateur de la Confédération paysanne et co-organisateur des tables rondes. L’idée, c’était de les visibiliser, parce qu’il y a un gros vide médiatique : je ne comprends pas pourquoi, lorsqu’on parle de pesticides, on donne la parole à de grandes ONG qui en font un sujet seulement quand il y a une actualité politique plutôt qu’aux concerné·es, en lutte depuis si longtemps, ajoute-t-il. Les amis de la Conf ’ et des collectifs locaux des Soulèvements de la terre étaient aussi présents, c’est la preuve que, peut-être du fait de la séquence Duplomb, il y a un décloisonnement du sujet, un intérêt plus large ».
Naomi, animatrice à Solidarité paysans (un mouvement de lutte contre l’exclusion en milieu rural), organisatrice de ce temps d’échange, complète : « Le but était vraiment de casser le clivage société civile victime/ travailleur agricole coupable, qui est souvent présumé et instrumentalisé. Lorsque ce sont, comme ici, des agriculteurs, eux-mêmes victimes des pesticides, qui prennent la parole et sont porteurs de réflexion, c’est plus difficile de renvoyer tout le monde dos à dos ». Mission accomplie : à la Confédération paysanne, où l’on est habituellement timide dans les prises de position sur la question, les échanges sont venus « rappeler que les malades étaient aussi des gens qui continuent à être dépendants de l’agrochimie, qu’il y a des nuances dans le discours, et des réflexions poussées sur le monde agricole. J’espère, et je pense, que ça va avoir une influence sur les orientations », atteste Amand.
« On a besoin d’épidémiologistes, de militants, de riverains, de chercheurs, d’avocats, de journalistes d’investigation… Il faut mettre en commun nos savoirs et sortir des clivages »
La première voix qui résonne sous ce chapiteau est celle de Fleur Breteau, fondatrice de Cancer Colère, en lutte pour la politisation de la maladie entre deux chimiothérapies. Elle a, ces dernières semaines, fait tonner sa rage dans l’hémicycle lors du vote de la loi Duplomb. Elle est ici pour témoigner, humble là où tous·tes connaissent son visage. « On est nouveaux dans tout ça, on aimerait créer des antennes locales », explique-t-elle, avant de demander l’avis des personnes présentes sur les actions à mener, sur le mouvement du 10 septembre en gestation et la manière d’y prendre part. Assez vite, les participant·es de cette assemblée se divisent en petits groupes où se mêlent agriculteur·ices, personnes malades, militant·es, chercheur·euses, chacun·e portant souvent au moins deux de ces casquettes. De chaque groupe émerge tout un panel de propositions concrètes :
• aider les agriculteur·ices à retracer l’historique des pesticides utilisés ;
• proposer des formations, des visites médicales de prévention et pour la reconnaissance des maladies, des rencontres dans les mairies, faire témoigner les victimes, afficher un « pestiscore » par commune ;
• se syndiquer et revendiquer le droit de vote pour les cotisant·es solidaires lors des élections professionnelles des Chambres d’agriculture ;
• accompagner les victimes devant la justice, organiser des actions puissantes en s’inspirant, par exemple, d’Act Up, tracter devant les hôpitaux ;
• faire pression sur les banques, assureurs, entreprises, bloquer les sites de production…
Tous·tes repartent gorgé·es de stimulation collective et muni·es d’une carte interactive répertoriant les groupes en lutte partout en France, adresse mail associée, afin de poursuivre l’esquisse d’un commun.
Aux Antilles, ni oubli ni pardon
La séquence Duplomb a mis la question des pesticides sur le devant de la scène écologique, mobilisant les ONG et influenceur·euses – avec un certain succès auprès de la société civile, comme en témoignent les plus de deux millions de signataires de la pétition s’opposant à cette loi. Cet agenda politique augure une cohésion nouvelle, vitale pour les collectifs locaux qui peuvent espérer disposer d’un peu plus de soutien et de lumière sur leurs actions. Mais ce sursaut national des sphères écolo laisse un goût amer à celles et ceux qui se battent depuis un demi-siècle, loin des frontières hexagonales : il n’a pas fallu attendre ce texte écocidaire pour que le chlordécone, insecticide toxique employé depuis le début des années 1970, fasse des ravages chez les travailleur·euses des bananeraies de Martinique et de Guadeloupe.
« Parler de la loi Duplomb en nous ignorant est une insulte pour nous », amorce Lilith lors d’une table ronde consacrée au colonialisme chimique. Membre du collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides (COAADEP), elle a fait un détour par Saint-Hilaire-de-Briouze pour rejoindre les Résistantes, alors qu’elle marche avec son compagnon Chacha, de Versailles à Saint-Brieuc, afin d’alerter l’opinion publique sur le scandale du chlordécone aux Antilles. Si tout un pan de la programmation portait sur l’écologie décoloniale, et que les soutiens venant de collectifs comme le CSVPO n’ont pas attendu cette séquence poli- tique pour se manifester, les liens entre les grandes associations et ONG de l’écologie hexagonale et les collectifs ultramarins en lutte contre les pesticides sont pour l’instant ténus. « Nos territoires sont des brouillons. On nous dit qu’il y a des pesticides en France, comme si nous n’étions pas la France. Peu importe notre santé, tant que nous exportons des bananes et du rhum en métropole, nous n’existons pas », laisse éclater Lilith.
C’est seulement en 2021 que le cancer de la prostate dû à d’une surexposition au chlordécone a été reconnu comme maladie professionnelle. En Guadeloupe et en Martinique, le recensement de ce cancer a été deux fois supérieur à celui estimé dans l’Hexagone entre 2007 et 2014, rappelle Lilith. À ce jour, l’insecticide a aussi été identifié comme perturbateur endocrinien et cause de lymphome. « On veut que nos histoires soient ressenties dans vos chairs, on veut que vous agissiez à votre échelle. On n’est pas la petite histoire du soir : on vit avec des empoisonnements et des traumas qui nous tuent encore et qu’on prend, malgré tout, le temps de vous raconter », pointe la marcheuse, la gorge serrée par une émotion qui saisit ses auditeur·ices, nombreux·ses à baisser les yeux – en attendant de faire mieux.
* Prénoms modifiés.
(1) Paul François, agriculteur, a été intoxiqué en 2004 par le Lasso, un herbicide anciennement commercialisé par la firme Monsanto. Après 14 ans de procédure aux côtés de son avocat Me Lafforgue, il a obtenu la condamnation du groupe et 11 000 euros d’indemnisation. Une maigre compensation, mais une victoire qui pourrait faire jurisprudence.