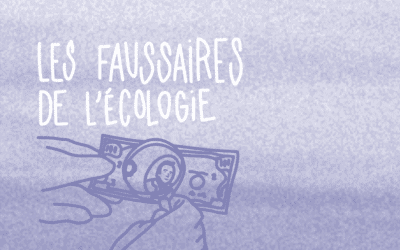Montée de l’extrême droite, percée de l’abstention, négation des résultats de référendums… Depuis près de deux décennies, la démocratie serait « en crise ». Avec la récente accélération de la décomposition politique, en France et en Occident, c’est tout l’édifice institutionnel bâti depuis le XVIIᵉ siècle qui chancelle. Pour la politologue et constitutionnaliste Eugénie Mérieau, la convergence des régimes libéraux et autoritaires dans une même zone grise nous commande d’imaginer d’autres formes démocratiques.
Biographie : Eugénie Mérieau est maître de conférence en droit public à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et spécialiste du constitutionnalisme autoritaire. Elle est l’autrice de plusieurs ouvrages, parmi lesquels La dictature, une antithèse de la démocratie ? (Le Cavalier bleu, 2019, revu et augmenté en 2024) et Géopolitique de l’état d’exception : les mondialisations de l’état d’urgence (Le Cavalier bleu, 2024), où elle analyse de manière critique les contentieux constitutionnels et la mondialisation de l’état d’urgence.
Cet entretien est issu du numéro 3 de Fracas. Photos : Marie Rouge.
Crise politique, crise de régime, crise de la démocratie… Comment distinguer ces termes, et lequel est pertinent pour décrire la situation présente ?
Lorsqu’on emploie l’expression « crise de la démocratie libérale », on désigne avant tout la crise du caractère libéral de la démocratie. L’idéal de la démocratie se porte plutôt bien au niveau global : le monde entier s’en réclame, y compris la Corée du Nord ou la Chine. C’est la façon de traduire cet idéal dans un gouvernement représentatif et libéral qui est aujourd’hui en crise. Elle est remise en cause à la fois par les idéologies libertariennes aux États-Unis et en Amérique du Sud, et par les mouvements nationalistes en Europe. Elle l’est également par les mouvements citoyens, qui découvrent subitement que la démocratie libérale est une vaste supercherie. À droite, on va considérer la démocratie libérale comme un obstacle à la liberté, et à gauche, à l’égalité. La fiction sur laquelle était fondée la démocratie libérale, c’est-à-dire le mariage entre Locke et Rousseau, entre l’égalité constituante du peuple et la liberté protégée par le constitutionnalisme, s’écroule sous nos yeux, et cela entraîne une vaste convergence entre régimes autoritaires et régimes libéraux.
Ce phénomène est-il réellement neuf ?
Cela fait longtemps que la crise de la démocratie représentative est identifiée. Ce qui est nouveau, c’est que la critique se radicalise de part et d’autre. Après un moment de relatif consensus sur ce modèle, à partir de la période où les partis communistes et d’extrême droite se sont effondrés après les « Trente Glorieuses », on assiste de nouveau à un bouillonnement et à une demande de changement radical. En cela, pour la gauche, même si la situation est dangereuse, la crise est une opportunité pour tout repenser, qu’il s’agisse de la forme représentative qu’a pris la démocratie ou de l’État lui-même. L’impératif pour les citoyens comme pour les intellectuels est aujourd’hui de proposer de nouveaux imaginaires, de nouvelles formes institutionnelles, et d’ouvrir des espaces pour les expérimenter. L’avancée de l’extrême droite sur le même terrain nous y contraint.
Ce qu’on appelle l’illibéralisme est-il vraiment quelque chose d’inédit ? Ou bien est-ce un « retour aux sources » des régimes libéraux ?
Si l’on en croit Samuel Huntington, la démocratie libérale a progressé dans le monde par vagues, avec des flux et des reflux. La première vague a lieu à la fin du XVIIIᵉ siècle, avec les révolutions française et américaine. Le monde connaît ensuite un long reflux qui nous amène jusqu’aux années 1930. Une seconde vague débute ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, avant de marquer le pas et de connaître un nouveau reflux dans les années 1960. La troisième et dernière vague prend sa source dans les années 1970, avec la Révolution des œillets au Portugal pour point de départ.
Aujourd’hui, nous sommes clairement dans le reflux de cette troisième vague, après qu’elle a connu un « pic » démocratique en 2006. Cela se traduit par des démocraties qui basculent dans la dictature au gré de coups d’État militaires, mais avant tout par un reflux des droits et libertés généralisé et mondial, auquel l’Occident n’échappe pas. En témoigne la situation aux États-Unis, où l’on voit la Cour suprême remettre en question des acquis tels que l’avortement, ou étendre de manière quasi-absolue l’immunité du Président.
La France non plus n’y échappe pas. Nous sommes en train de revenir très nettement sur tous les acquis de la IIIᵉ République : la liberté d’association, la laïcité, la liberté de la presse… la liste est longue. Aujourd’hui, on revient sur les grandes libertés, mais cette restriction concernait jusqu’ici essentiellement les musulmans, toujours suspects de terrorisme. Cela n’est pas sans rappeler la période du code de l’indigénat sous la IIIᵉ République. Mais la catégorie est en train de s’élargir pour y ajouter de nouvelles franges de la population : les « écoterroristes », les Gilets jaunes, etc.
« Le niveau de violence et de répression d’un État ne dépend pas de sa nature libérale ou autoritaire : ce qui définit le niveau de violence, c’est le degré de menace que fait peser sur le régime une contestation »
À quoi est dû ce reflux ?
La thèse que je développe dans mon dernier livre, Géopolitique de l’état d’exception, est que ce reflux a toujours partie liée à la mondialisation de l’état d’urgence. Les trois grandes vagues que j’ai décrites correspondent également à l’invention de nouveaux droits : droits civils et politiques pour la première, droits sociaux et économiques pour la seconde, droits environnementaux pour la dernière. Après chaque vague de mondialisation des libertés, une vague d’états d’urgence leur a succédé et est venue les suspendre. Et lorsque ces états d’urgence ont fini par se mondialiser, on a assisté au reflux généralisé de la démocratie.
Comment cela s’est-il passé ?
Au XVIIIᵉ siècle, alors qu’on proclame l’universalisme des droits humains, on invente l’état d’urgence pour suspendre cette protection dans l’empire colonial sans fragiliser la fiction de leur universalité. Pendant la Première Guerre mondiale puis dans les années 1930, cette suspension des droits a connu un mouvement de retour de la « périphérie » coloniale vers le « centre ». Et on a fini, partout en Europe, par retirer au Parlement sa capacité à légiférer en gouvernant massivement par décrets. On ne parle pas encore alors d’état d’urgence en France – pas avant 1955 – mais de « circonstances exceptionnelles » qui justifient que l’administration s’affranchisse de l’État de droit. C’est ce qui va préparer le terrain au régime de Vichy.
En Allemagne, la situation est tout à fait similaire. On y légifère presque uniquement par décrets-lois sur la base de l’article 48 de la Constitution de Weimar – Constitution sur laquelle est d’ailleurs décalquée celle de la Vᵉ République. Lorsque le régime d’état d’urgence est décrété en 1933, il s’inscrit dans la continuité de l’utilisation à répétition de l’article 48, et c’est ce qui finit par plonger l’Allemagne dans le nazisme. Le même phénomène est observable en Italie et ailleurs en Europe.
Lors de la seconde vague, la même chose se reproduit. Les communistes sont alors très puissants et les idées socialistes ont fait leur chemin, de même que le désir d’indépendance des colonies. La loi d’état d’urgence de 1955 va venir suspendre les droits des Algériens pendant la guerre et permettre de se soustraire au droit international de la guerre. Certes, la France n’a pas connu le grand plongeon dans la dictature qui s’est produit dans le reste du monde à cette période, particulièrement en Amérique latine, mais on observe néanmoins des choses qui s’en approchent. De Gaulle, en 1961, déclare l’état d’urgence et se sert de l’article 16 de la Constitution pour le prolonger indéfiniment, ce qui est, en temps normal, la définition d’un coup d’État. Lorsqu’on change de régime pour passer à l’élection du Président au suffrage universel en 1962, on est encore sous état d’urgence, sans validation du Parlement. Si cela s’était passé ailleurs dans le monde, on aurait affirmé que ces élections n’étaient pas libres. L’article 16 a également été employé pour mettre en place des tribunaux d’exception avec peine de mort, sans possibilité de faire appel devant une juridiction, ce qui est contraire au principe de jus cogens, c’est-à-dire une norme impérative du droit international à laquelle il est interdit de déroger même sous état d’urgence…
Qu’en est-il de la troisième vague ?
Le reflux actuel se caractérise également par une succession d’états d’urgence et par leur mondialisation. Je précise que Donald Trump, le jour de son investiture, a déclaré la loi martiale, à la frontière avec le Mexique, alors qu’il ne se passait absolument rien d’exceptionnel. J’ai écrit Géopolitique de l’état d’exception il y a deux ans et, à vrai dire, je n’aurais jamais cru qu’on en serait déjà là en 2025… Il devient de plus en plus manifeste que le libéralisme, que l’on voit ici sous sa forme radicale dans l’imaginaire libertarien aux États-Unis, porte en lui l’état d’urgence et la dictature.
Trois dates me semblent parlantes pour identifier les moments de bascule de ce troisième reflux. En 2001, les attentats du 11 septembre ont été l’occasion de mondialiser l’état d’urgence antiterroriste ; ce qui a montré à tous que la démocratie libérale n’était ni la paix ou la sécurité, ni le respect du droit international. En 2008, la crise des subprimes a permis la mise en place d’un état d’urgence économique, c’est-à-dire l’austérité, montrant par la même occasion que la démocratie libérale, ce n’est ni la prospérité, ni le respect de la démocratie – les Grecs en savent quelque chose. Enfin, en 2020, le Covid a justifié la mondialisation d’un état d’urgence sanitaire, montrant que la démocratie libérale n’est même plus la liberté d’aller et venir. Ces trois moments ont fendillé la fiction libérale et accéléré sa décomposition.
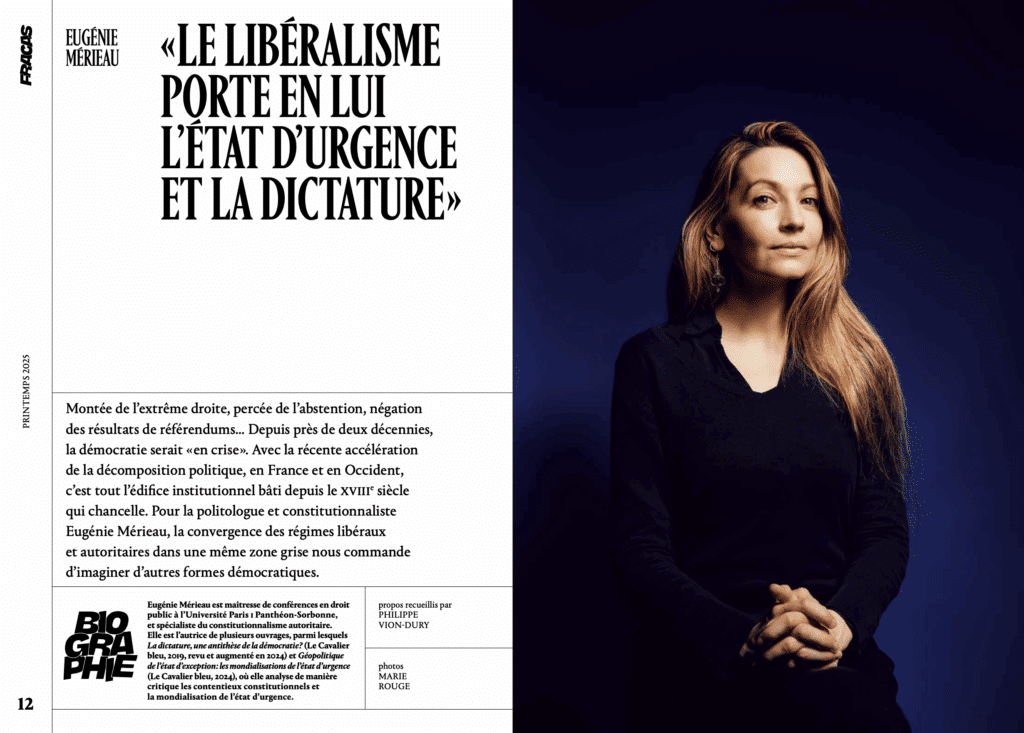
L’effarement d’une partie de la population devant la tournure que prennent nos systèmes vient-il du fait que ce ne sont plus seulement des groupes minoritaires ou marginalisés qui sont pris pour cible ?
En France, les Gilets jaunes ont marqué le moment où des techniques coloniales ont été utilisées sur des Blancs. Historiquement, l’état d’urgence avait été utilisé essentiellement sur le sol algérien, calédonien… En 2018, les LBD sont braqués sur des Français blancs, métropolitains, et l’on voit même l’impensable se produire lorsque des blindés font irruption sur les Champs Élysées. La prise de conscience de la dimension coloniale du pouvoir et du fait que la police est au service d’intérêts de classes a été brutale, effritant la croyance en un État neutre, au service de l’intérêt général. Pendant toute cette période, par ailleurs, l’Union européenne a vraiment incarné le libéralisme autoritaire, c’est-à-dire la suppression de mécanismes démocratiques au service du néolibéralisme, au service du marché.
Si la fiction s’est effondrée, si le masque démocratique est tombé, que reste-t-il ?
Les intérêts économiques, les propriétaires, l’oligarchie. Les droits socio-économiques ou environnementaux (dits de deuxième et de troisième génération) resteront toujours inféodés au droit de propriété, ils n’ont aucune espèce d’effectivité, comme en témoignent les jurisprudences des pays occidentaux. Ils ne sont qu’un alibi pour légitimer les droits civils et politiques des propriétaires (les droits de première génération), c’est-à-dire le droit de jouir égoïstement de ses propriétés. Depuis John Locke, les libertés et les droits de l’homme sont conçus à partir du droit de propriété, des droits subjectifs attachés à des individus supposés autonomes et rationnels. On oppose à l’État notre liberté quand celui-ci vient nous la retirer, et les libertés sont pensées comme des relations du propriétaire sur sa chose, sa liberté. C’est la critique marxiste classique.
D’ailleurs, on assiste ces temps-ci à un vrai retour de la critique marxiste du droit, et en particulier des droits subjectifs, qui a pendant un temps été quelque peu évincée par d’autres lectures plus « réformistes » en termes de genre, de race. Mais il faut réussir à mobiliser l’ensemble de ces critiques pour comprendre ce qui se joue au cœur de l’idéologie libérale depuis sa genèse. La liberté telle que définie et protégée par le contrat social-libéral n’est autre que l’intérêt individuel et ne peut s’exercer que via la domination d’une classe sur une autre.
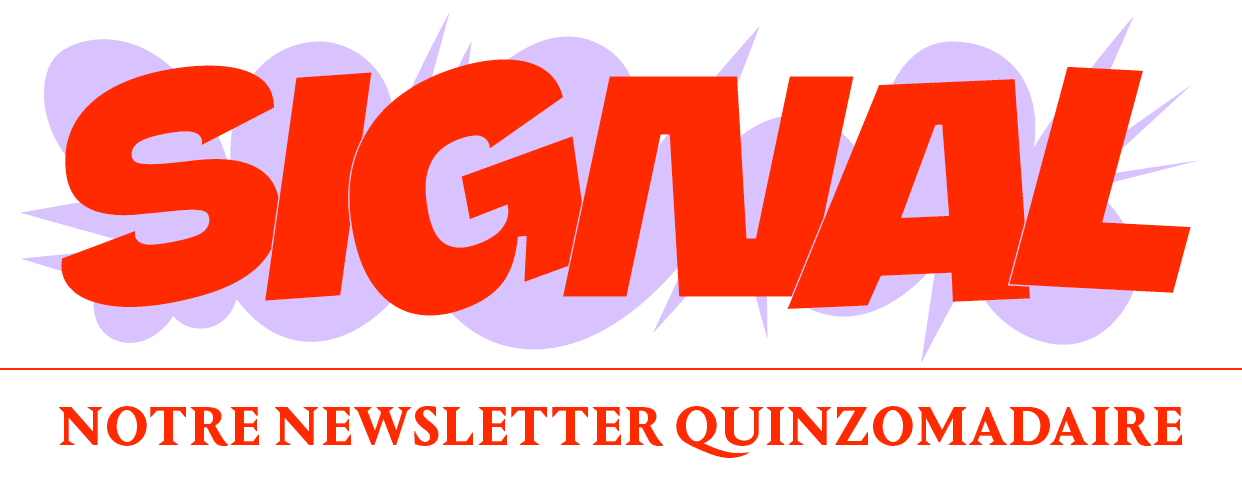
Dans ce cas, avons-nous affaire non pas à une « dérive autoritaire » des régimes démocratiques, mais à la fin d’une « dérive démocratique » des régimes libéraux ?
Je le pense. Je me rappelle qu’il y a 20 ans, pendant mes études à Sciences Po, on interprétait déjà l’abstention comme un signe de la crise de la démocratie représentative. Or, on peut considérer que l’abstention est le socle même de la démocratie représentative. Si le vrai objectif de la démocratie représentative est de confisquer une part du pouvoir et le remettre aux mains d’une élite, alors l’abstention remplit bien sa fonction.
Au départ, la démocratie représentative se fonde sur un suffrage censitaire, réservé au seul propriétaire, qui s’est peu à peu universalisé. Et on y revient, de facto, puisque aujourd’hui, plus on est propriétaire, plus on vote. L’abstention ne doit pas être interprétée comme le symptôme d’une crise, mais plutôt comme le signe que le système fonctionne bien et parvient à exclure les intérêts des plus défavorisés de la représentation nationale ! C’était déjà l’objectif de Sieyès, à la fin du XVIIIᵉ siècle. C’est lui qui invente l’idée d’un « pouvoir constituant » supposément illimité, et en même temps, il affirme aussi que la France ne doit en aucun cas devenir une démocratie, mais bien un régime représentatif, à rebours des idées de Rousseau qui critiquait le principe électif comme une dénaturation de l’idée de démocratie, qui ne pouvait être que directe, avec non pas des représentants mais des commissaires. Sieyès insiste bien sur le fait que le mandat ne doit surtout pas être impératif pour que les représentants ne rendent pas de comptes au peuple qui les a élus. Aujourd’hui, c’est inscrit à l’article 27 de notre Constitution : « tout mandat impératif est nul ».
Certains historiens influents comme François Furet feront ensuite des démocrates de la Révolution française comme Robespierre, voire pour certains Rousseau, les précurseurs du totalitarisme. La Révolution française, associée à la « Terreur », est devenue la « preuve » que le gouvernement représentatif est le seul système possible. L’Histoire et l’histoire des idées telles qu’on nous les enseigne sont une fable visant à nous empêcher de penser des alternatives à cette forme de gouvernement qu’est le gouvernement représentatif.
Le Conseil constitutionnel ou l’État de droit nous étaient présentés comme des « garde-fous » du caractère démocratique de nos systèmes. Or, ceux-ci sont maintenant attaqués par un pouvoir exécutif, qui ne fait même plus semblant de les respecter. Mais ce faisant, il affaiblit d’autant plus la fiction de la démocratie libérale… N’est-ce pas paradoxal ?
Effectivement, les attaques viennent de tous les côtés. La droite dénonce le « gouvernement des juges », la gauche voit en eux des « leurres » démocratiques et des fictions, et même l’extrême centre s’y met en n’essayant même plus de cacher qu’elle ne les respecte pas. Mais difficile de savoir si c’est une démonstration de force ou une preuve de faiblesse… ou les deux ! En tous cas, le parallèle avec les années 1930 se justifie pleinement. Plus personne ne respectait la république de Weimar et le parlementarisme, ni la droite qui la jugeait faible et stérile, ni la gauche qui la jugeait anti-démocratique, ni dans ce qu’on appellerait aujourd’hui l’extrême centre qui la jugeait un peu trop sociale et pas assez ordonnée. On a vu alors comment les libéraux ont jeté la république de Weimar en pâture aux nazis, par pures manœuvres électorales court-termistes et par intérêt de classe.
La France est-elle devenue une démocratie illibérale ?
On peut comparer la trajectoire d’Emmanuel Macron à celle de Viktor Orbán. On a, dans les deux cas, un parcours qui commence à « gauche » dans la jeunesse et qui dérive vers la droite, jusqu’à doubler la droite sur sa droite. On se souvient de Gérald Darmanin accusant Marine Le Pen d’être trop « molle ». Le parti d’extrême droite hongrois historique Jobbik est aujourd’hui davantage au centre de l’échiquier politique que le parti d’Orbán. Les derniers mois ont été, en France, marqués par plusieurs violations – qu’on appelle poliment « détournements » ou « interprétations contestées » de la Constitution. On a tout de même gouverné par gouvernement démissionnaire pendant 51 jours ! Les constitutionnalistes n’osent pas dire qu’on est dans un pays où il est devenu banal de violer la Constitution, car cela fait s’écrouler la fiction : la Constitution en sortirait désacralisée, et il deviendrait encore plus facile de la violer. On a donc tendance à toujours vouloir interpréter les actes politiques comme étant en accord avec une « certaine lecture » de la Constitution. C’est à peine si la proposition de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel (1) provoque quelques tribunes…
« Notre problème, c’est que nous n’avons pas de contre-modèle aujourd’hui. Si la France et la Russie sont gouvernées sur le même modèle, où aller en chercher un autre ? »
Qu’est-ce qui nous sépare, en définitive, des régimes que l’on considère comme dictatoriaux ou autoritaires ?
J’essaie de montrer dans mes travaux que la manière dont on pense la Vᵉ République, à l’image de la manière dont on pense la démocratie libérale, est construite par une autre fiction, son miroir inverse : la dictature. Or, la Vᵉ République est un copier-coller de Weimar avec encore moins de contreseings, et des pouvoirs propres pour le Président, chose qu’on ne retrouve aujourd’hui qu’en Russie et dans quelques autres pays. L’architecture de notre régime est plus proche de celle de la Russie que de n’importe quel système parlementaire dans le monde. Nous vivons dans le déni de ce fait – ce qu’on me fait généralement remarquer dans les colloques internationaux.
Pour ce qui est de la dictature, on a inventé une image de celle-ci qui nous permet de nous figurer que nous sommes l’exact contraire. Or, comme dans les démocraties, on y retrouve des constitutions, des élections et des manipulations électorales, des suspensions de droits et libertés par états d’urgence, etc. Une différence marquée entre les deux se situe généralement au niveau de la liberté d’expression : mais ce mythe est en train de voler en éclats en France, alors que la critique se fait de plus en plus radicale. Comme le disait Rosa Luxemburg : « Celui qui ne bouge pas ne sent pas ses chaînes. » Depuis qu’on commence à bouger et à remettre en question le consensus libéral, on découvre qu’il y a des chaînes… La liberté d’expression est bien un marqueur de distinction, qui m’intéresse en tant qu’anthropologue du droit ou « comparatiste », mais non pas pour discriminer entre bons et mauvais régimes, mais en ce qu’il montre que, d’une société à l’autre, les « chaînes » ne sont simplement pas au même endroit.
Par exemple ?
En Thaïlande, un pays sur lequel j’ai beaucoup travaillé, vous ne pouvez pas critiquer le roi, mais vous pouvez insulter le gouvernement sans problème. Vous pouvez aussi dire que le Hamas est un mouvement de résistance, soutenir la Palestine sans être inquiété pour apologie du terrorisme… il n’y a aucune loi mémorielle. En Europe, on a interdit Russia Today ou Spoutnik sur la base d’une décision de la Commission européenne sans aucun fondement juridique – protéger de la « désinformation » ? Dans le même temps, l’infraction d’apologie du terrorisme est utilisée pour interdire de façon préventive les manifestations et criminaliser tout soutien à la Palestine.
En réalité, le niveau de violence et de répression d’un État ne dépend pas de sa nature libérale ou autoritaire : ce qui définit le niveau de violence, c’est le degré de menace que fait peser sur le régime une contestation. Le niveau de violence physique peut être très faible dans des États autoritaires qui rencontrent peu de contestation interne, et très fort dans des régimes libéraux qui prennent peur face à la rue. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes a été réprimée sévèrement pour cela : elle ouvrait un imaginaire hors de l’État, et a provoqué une réponse étatique complètement disproportionnée.
Si le couple dictature-démocratie libérale s’apparente davantage à un spectre tout en nuances, en degrés, plutôt qu’à une opposition franche, de nature, il y a quand même eu des régimes totalitaires…
Il ne s’agit pas de minimiser la violence des régimes staliniens ou nazis. Hannah Arendt a créé cette catégorie de totalitarisme pour définir un régime fondé sur la terreur, ce qui paraît essentialisant et forcément réducteur. Elle est assez ambivalente, mais elle fait partie, dans une certaine mesure, de ceux qui établissent une filiation entre la « Terreur » de la Révolution française et les totalitarismes. Ce qui me gêne dans son approche – et peu de gens travaillent encore avec ses outils aujourd’hui –, c’est qu’elle ôte deux régimes de la matrice du comparatisme. C’est le même procédé que pour démocratie-dictature : cela permet de ne pas les comparer. Ils deviennent des impensables, des parenthèses inexplicables. Pourtant, comme l’écrivait Aimé Césaire, le caractère exceptionnel du crime des nazis n’a pas été l’invention du génocide, mais la mise en pratique du génocide contre des Blancs.
Y a-t-il une voie de sortie de ce dualisme libéral-autoritaire ?
C’est à nous d’inventer quelque chose de radicalement différent. Quand Montesquieu, dans L’Esprit des lois, décrit la Chine comme « un État despotique, dont le principe est la crainte », une monarchie sans légalité où « un seul gouverne, mais sans règles préétablies, donc par ses caprices et sa propre volonté », il tend en réalité un miroir à la monarchie absolue en France. C’est le même procédé que celui qu’il avait utilisé auparavant dans les Lettres Persanes. Son modèle à lui, c’est le Royaume-Uni, et c’est ce qu’il propose en contre-modèle de la Chine. Notre problème, c’est que nous n’avons pas de contre-modèle aujourd’hui. Si la France et la Russie sont gouvernées sur le même modèle, où aller en chercher un autre ?
En France, l’analyse répandue, y compris à gauche et même à la France insoumise, est qu’on a plutôt affaire à une crise de régime, la crise de la Vᵉ République, c’est-à-dire d’un régime libéral semi-présidentiel… Et on peut avoir l’impression que du point de vue institutionnel, les partis de gauche ne désirent pas autre chose qu’un système parlementaire « à l’allemande », pourtant lui aussi en crise (2)…
Le parti-pris de la France insoumise est de simplement demander une assemblée constituante, composée par des élus ou issue du tirage au sort, et que c’est à elle de décider. Mais il est vrai qu’on perçoit plutôt un désir de régime parlementaire, et c’est dommage.
Sans s’en référer à un modèle clé en main, y a-t-il des pistes auxquelles on devrait prêter davantage attention ?
Il y a la question du référendum. Nous n’avons pas en France de vocabulaire à ce propos. On a qu’un seul mot qui recouvre le référendum d’approbation, d’initiative, de révocation, de plébiscite, etc. La gauche a fait une erreur en laissant ce sujet à la droite qui, du RN à Emmanuel Macron, a commencé à l’investir.
La proposition de la France insoumise de lancer un processus constituant via l’article 11 est intéressante bien que problématique, car s’inscrivant dans les traces de la violation historique de la Constitution par le général de Gaulle en 1962, lorsqu’il fait adopter l’élection du Président au suffrage universel direct. Le pari est que, sans connaître exactement la destination, il s’agit déjà d’ouvrir un chemin, c’est-à-dire un espace d’expérimentation et de discussion collective. Comme l’écrit René Char dans Feuillets d’Hypnos, « l’homme est capable de faire ce qu’il est incapable d’imaginer » ! Mais ce n’est pas gage de réussite : le processus constituant chilien (3), qui était très ouvert, a pourtant échoué.
On peut aussi se demander s’il ne faut pas laisser tomber l’option de la Constituante et passer plutôt par des zones d’expérimentation, par le principe fédératif cher aux anarchistes, qui part d’en bas, à l’opposé d’un processus constituant, qui partirait d’en haut. L’Islande est parvenue à produire une Constitution au terme d’une écriture collective. Car le risque serait de voir le processus constituant confisqué par Macron, par le Rassemblement national, ou même par la France insoumise, où l’on se retrouverait avec un recommencement.
Qu’est-ce que l’écologie peut apporter dans tout ça ?
La nouvelle donne, par rapport au reflux des années 1960-1970, c’est l’écologie. Elle est venue mettre en cause tous les grands récits : le progrès, la science, la technique, l’État… Tous les fondements même de notre modernité. Et toutes les formes politiques qui vont avec. Mais il y a une contradiction entre les échéances : il faut à la fois ouvrir des imaginaires lointains, mais aussi réfléchir à ce qu’il va se passer demain.
Je mettrais aussi en garde les écologistes contre le désir de constitutionnalisation, c’est-à-dire de gagner des procès et inscrire dans la Constitution de nouvelles dispositions environnementales. Il ne faut pas oublier que ce que l’on confie au juge, on le retire de la délibération populaire. Lorsque l’on inscrit une chose dans la Constitution, on la confie au juge, qui va mettre en balance différents principes. Veut-on vraiment que le juge ait le dernier mot dans la conciliation entre le droit de propriété et le droit de l’environnement ? Aujourd’hui, il tranchera toujours en faveur du premier. Dès lors, les victoires ne sont plus que symboliques. Tout cela n’est-il pas, en définitive, de la diversion ? Une canalisation de l’énergie vers des fausses victoires pour empêcher un vrai combat écologique ?
Notes :
(1) En février 2025, l’ancien Président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand, réputé proche d’Emmanuel Macron, a été nommé à la tête du Conseil constitutionnel, malgré une modeste compétence juridique et une mise en examen pour « prise illégale d’intérêts » dans l’affaire des Mutuelles de Bretagne.
(2) Lors des législatives de février 2025, le parti d’extrême droite allemand Alternative für Deutschland (AfD) a recueilli 20,8 % des suffrages et s’est imposé comme la deuxième force du pays. Le paysage politique allemand, à l’instar de la France, connaît une recomposition tripartite entre gauche, centre droit et extrême droite.
(3) Le Chili a connu un processus constituant de 2021 à 2023 qui s’est clôt par le rejet de la nouvelle Constitution soumise au référendum. Si les raisons de cet échec sont multiples, le processus constituant a fait l’objet d’une offensive politique massive dans un paysage médiatique largement détenu par la droite conservatrice.